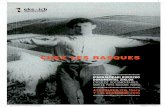TROPISMES NATURELS ET TROPISMES LITTERAIRES CHEZ … · en el siglo XIX y en la primera mi-tad del...
Transcript of TROPISMES NATURELS ET TROPISMES LITTERAIRES CHEZ … · en el siglo XIX y en la primera mi-tad del...
-
38Castro
la eliminación de la intriga y el per-sonaje.Tropismo: reflejo a una excitación exterior, que se traduce por una secuencia de monólogos informes, irreflexivos, incoherentes. Natalie Sarraute y la Nueva No-vela: menos compleja que otras técnicas utilizadas por los “neo-novelistas”, -Claude Simon. Alain Robbe-Grillet, etc- la utilización sistemática del Tropismo da a la escritora, una indudable originali-dad y autenticidad.
Nathalie Sarraute (1) occupe aujourd’hui une place assez remar-quable dans la littérature françai-se de la seconde moitié du siècle dernier. Non pas, sans doute, une place de relief comme ce fut le cas dans les années 60, au moment du tohu-bohu universitaire qu’elle suscita et de la critique oficielle et académique qui portèrent aux nues ses romans.
La “Nueva Novela”, que supone una revolución del concepto de Novela, en los años 60, se caracte-riza por la desaparición de la intri-ga, la psicología y el personaje, tal como lo entendía la literatura rea-lista anterior a esta fecha. Entre los “neonovelistas”, Natalie Sarraute ocupa un lugar especial: sus rela-tos, prácticamente sin personaje ni intriga, se sostienen en un inter-minable chismorreo y cuchichear que reflejan no la psicología del personaje, sino el flujo de la sub-consciencia y la subconversación. La “sospecha”, que ella erige como motor de la creación literaria est total, sin concesión con la novela realista, psicológica, tan en voga en el siglo XIX y en la primera mi-tad del siguiente.
Palabras claveNueva Novela: corriente litera-ria que florece entre 1950 y 1970 cuyo objetivo es liberar el relato del realismo descriptif, mediante
TROPISMES NATURELS ET TROPISMES LITTERAIRES CHEZ NATHALIE SARRAUTE
Jaime CASTRO [email protected]
Canciller de la Universidad Iberoamericana del EcuadorQuito-Ecuador.
Resumen
-
39 Qualitaslittérature contemporaine, celle de la deuxième moitié du XXe siècle, « Nathalie Sarraute occupe une place solitaire extrêmement origi-nale »(2), bien qu’elle ne s’oppose pas, par principe, par ses réflexions théoriques à celles de ses contem-porains qui cherchent à quitter les sentiers battus du roman tradition-nel. Ils ont ensemble au moins un point en commun, ils ont subi les influences de Dostoïesvki, Joyce, Kafka, Proust, Faulkner, et pour elle de Virginia Wolf.
Et N. Sarraute le confirme: « le jeune écrivain qui aurait le bonheur d’avoir le tempéra ment de Stendhal ou de Balzac, et de ce fait, écrirait aujoud’hui comme eux, ferait penser à un physicien moderne qui poursuivrait ses recherches sans tenir compte des travaux d’Einstein ou de Planck. Ainsi, quand nous avions commencé à écrire, la réalité que nous connaisssions a été mofifiée par les écrivains qui nous ont précédés »(3).
Mais la question fondamentale pour N. Sarraute, et les autres « néoro-manciers », est celle de savoir si une connaissance véritable, objective, des hommes et du monde est-elle encore possible, après les fonda-
Cette place s’explique, en par-tie, par le rôle d’initiatrice qu’elle acquis en publiant son premier ouvrage Tropismes, en 1939, sur les presses de Robert Denoël, après avoir été refusé par deux grands noms de l’édition française, Galli-mard et Grasset, où elle s’attache à la description minutieuse des mouvements que effleurent no-tre conscience et manifestent nos sentiments, et qui fait de la roman-cière l’ancêtre et l’accompagnatrice de ce qu’on a appelé par la suite le « Nouveau Roman ».
S’agissant de déterminer la place de N. Sarraute et de définir son originalité à l’intérieur de ce « mouvement », nous recourrons à l’utilisation qu’elle fait du mot Tro-pisme en nous appuyant d’abord sur le sens premier, biologique pour ainsi dire, puis littéraire, du terme, qu’elle utilisa frequemment au point de le prendre comme titre d’un de ses romans, le plus repre-sentatif en ce qui concerne sa ma-niere et son univers romanesque.
1. Une romancière à la place ori-ginale
« Personne, ni écrivain, ni public, ne sait plus à quoi s’en tenir », observe l’écrivain Julien Grac en 1950, en parlant du roman. Ce séisme général qui a secoué la
-
40Castro
mentales transformations qui ont marqué la deuxième partie du XIXe siècle et la moitié du siècle sui-vant. Si tout est subjectif, instable, le monde objectif cesse tout natu-rellent d’être la préoccupation ma-jeure de ces auteurs qui remettent le roman en question. Il ne s’agit plus pour eux de faire du roman la version esthétique, littéraire de la réalité sociale, économique, pas même psychologique, comme le prétendaient Balzac, Stendhal, Zola, et même l’incontournable Proust, pour n’en citer que quelques-uns. Le roman devient une succession de points de vue, de moments qui ne reposent pas sur la description psychologique traditionnelle.
En d’autres termes, ces néoro-manciers remettent en question, et vont jusqu’à rejeter en bloc les différentes voies dans lesquelles les romanciers traditionnels se sont engagés –le roman réaliste, psychologique- mais en même temps « ils s’impatientent et cher-chent déjà, pour échapper à des difficultés actuelles, d’autres is-sues » (4).
Ils sont de leur côté engagés dans la recherche d’un nouvel équilibre et d’une nouvelle manière. Cette période de remise en question est celle que Sarraute appelle l’ « Ere du soupçon ». Ainsi, le soupçon
vis-à-vis des formes traditionne-llles, éveillé par l’ambigüité du monde moderne en perpétuellle mutation, se retrouve chez la plu-part des auteurs de cette époque. « Publiée en 1956, mais composée pour moitié de textes antérieurs, L’Ère du soupçon peut passer pour le premier manifeste avant la let-tre du nouveau roman. Nathalie Sarraute n’y revendique guère d’inspirateurs français. Elle analy-se comment Kafka a hérité de Dos-toïevski plus que de Proust cet uni-vers où “ ne reste qu’une immense stupeur vide, un ne-pas-compren-dre définitif et total “. Le soupçon naît du moment où les œuvres sont envahies par “ un je anon-yme qui est tout et qui n’est rien et qui n’est le plus souvent qu’un reflet de l’auteur lui-même “, dis-créditant le tout-puissant et trop transparent personnage balzacien »(5). Soupçon donc envers les cer-titudes offertes par la psychologie, la philosophie et la littérature.
Et lorsqu’ Alain Robbe-Grillet dit que la surface des choses a cessé d’être pour les écrivains le masque de leur « coeur », il confirme davantage la tendance nouvelle des oeuvres littéraires qui est d’ s’affronter à l’énigme de l’invisible confusion interne. Et en composant son oeuvre, le roman-cier d’aujoud’hui écrit « le roman
-
41 Qualitas2. Nathalie Sarraute et Le Nouveau Roman
Nous avons mentionné à plusieurs reprises la nouvelle génération d’écrivains qui voit le jour dans les années 50, parmi lesquels figure N.
Sarraute, et qu’on réunira, à leur insu, sous le nom de « Nouveau Roman ». Cependant, malgré la fortune qu’a connue cette déno-mination, avec des noms illustres comme Robbe-Grillet, Claude Si-mon, Michel Butor, Claude Pinget, Claude Ollier, Jean Ricardou, il est évident que chacun des écrivains rangés sous cette bannière est en-gagé dans sa voie propre et que tous refusèrent de s’aligner sous la même bannière ou signer un ma-nifeste comme avant eux le firent nombre de mouvements ou écoles littéraires.
Il reste à définir les modalités et les limites de l’appartenance de N. Sarraute à ce mouvement, et partant son originalité, c’est-à-dire en quoi elle s’en différencie net-tement et par quels traits elle s’y rattache avec non moins de force.
d’un roman qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire » (6). Il ne s’arroge plus une connaissance et une maîtrise quasi divines ; il obli-ge désormais le lecteur à fournir un effort continuel interactif, et à s’identifier tantôt à l’écrivain tan-tôt au personnage.
Le bouleversement, on l’ déjà dit, en outre, l’instabilité des caractères est, surtout pour N. Sarraute, le seul moyen eficace pour suggérer au lec-teur la complexité humaine toujours et davantage indiscernable.
Pour ce faire, N. Sarraute est en-tré le plus profondément dans le monde de la sous-conscience. Elle s’y aventure pour expliciter la vraie nature de l’homme, lequel ne peut être étiqueté, car tout est en « passage », en transition. La sous-conversation ou brives de conversations, aboutit à la sous-conscience.
N. Sarraute s’affirme sur cette pis-te déjà explorée avant elle, par exemple, par l’auteur d’Ulysses, James Joyce, grâce à l’exploration de ce qu’elle appelle « tropisme » et ouvre en même temps la voie à une nouvelle génération de ro-manciers.
-
42Castro
de toute histoire, la déconstruction d’un récit chronologique.Ajoutons encore une autre défini-tion dans une perspective histori-que:
« Le Nouveau roman » est un mouvement littéraire des années 1953-1970, regroupant quelques écrivains appartenant principalement aux Editions de Minuit. Le terme fut créé, avec un sens négatif, par le critique Emile Enriot dans un article du journal Le Monde du 22 mai 1957, pour critiquer le roman la Jalousie, d’Alain Robbe-Grillet et Tropismes de Nathalie Sarraute. Le terme sera exploité à la fois par des revues littéraires désireuses de créer de l’actualité ainsi que par Alain Robbe-Grillet qui souhaitait promouvoir les auteurs qu’il réunissait autour de lui, aux Editions de Minuit, où il était conseiller éditorial. Il précède de peu la Nouvelle Vague qui naît en octobre de la même année » (8), Nouvelle Vague qui apporta une bouffée d’air frais et renouvela la création cinematographique (cf. François Truffaut, Jean-Luc Godard, etc).
Au « réalisme » du roman tradition-nel, qui est loin de rendre compte de la véritable vie intérieure des
Définissons en premier lieu les caractéristiques de ce mouve-ment, et sa volonté de remettre en cause les formes de la fiction et les conventions romanesques telles qu’elles sont pratiquées de-puis le XIXe siècle. A la différence du récit traditionnel attaché à la psychologie de héros et à la linéa-rité de l’intrigue, ils inventent de nouveaux procédés narratifs. Ce sont
“des œuvres publiées en Fran ce à partir des années 1950 et qui ont eu en commun un refus des catégories considérées jusqu’alors comme constitutives du genre roma nesque, notamment l’intrigue - qui garantissait la cohérence du récit - et le personnage, en tant qu’il offrait, grâce à son nom, sa description physique et sa caractérisation psychologique et morale, une rassurante illusion d’identité ».(7)
Le lecteur qui s’imaginait que le roman a pour fonction de distrai-re en racontant une histoire, aussi vraissemblable que possible, à la Zola par exemple, se trouve désor-mais face à un récit qui se propose comme objetif premier la négation
-
43 Qualitas
Il nous semblé opportun, à ce sta-de, au sujet d’une époque assez lo-intaine et insuffisamment connue, énumérer les principaux et plus lus des « nouveaux romanciers »
• Samuel Beckett • Michel Butor (romans de
la première partie de son œuvre)
• Marguerite Duras (seule-ment pour quelques ouvra-ges)
• Claude Ollier • Robert Pinget • Jean Ricardou • Alain Robbe-Grillet • Nathalie Sarraute • Claude Simon
3. Les Tropismes
Ce sont précisément les tropismes qui distinguent nettement Natha-lie Sarraute du reste de ses con-temporains.
En effet, N. Sarraute s’est spéciali-sée dans l’art d’explorer les profon-deurs et les méandres de la sous-conscience, siège des tropismes.Ce titre de son premier ouvrage pourrait s’apliquer à tous ses ècrits. C’est en effet le thème essenciel
personnages, ils opposent un au-tre type de réalisme qui repose sur l’inextricable et désordonné déroulement de la conscience, comme si la réalité du monde et de l’humain se résumait en ces in-cohérences des réactions affecti-ves et intellectuelles. En cela, elle rejoint les thèses de Sartre et des autres existentialistes, leurs con-temporains.
Parallèlement, ces romanciers dé-veloppent, avec un sens aigu du soupçon, une réflexion théorique constante et nouvelle sur la vali-dité du roman, son contenu et son devenir, accordant une place de choix, sinon la seule, à la forme, au déroulement formel, arrivant à la conclusion que le roman ne consis-te pas à raconter une histoire, com-me le lecteur espérait et s’imaginait jusqu’alors, sinon à soutenir, au contraire, l’impossibilité de décrire le réel, comme il serait complète-ment impraticable ou même ab-surde de s’atteler à une tragédie de type racinien. Stendhal, par exem-ple, ou Balzac, appartiennent à une époque absolument revolue qui ne saurait être en aucune façon celle du romancier qui a connu les deux guerres mondiales et les boulever-sements sociaux et politiques qui s’en sont suivis.
-
44Castro
rapidement aux limites de la cons-cience ; ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles.
Appliqués aux relations humai-nes, les tropismes résument en une certaine mesure la vie psy-chologique dynamique enfouie au fond de l’être et qui échappe à la conscience lucide, renvoient à des « sentiments fugaces, brefs, inté-rieurs, mais inexpliqués : phrases stéréotypées, conventions socia-les ; sous la banalité apparente des ces conventions du discours, il existe en effet des rapports hu-mains complexes, des sentiments internes parfois violents déclan-chés par la présence d’autrui ou par les paroles de autres » (10). En d’autres termes, des réactions pour ainsi dire physiques.
La présence d’autrui par exemple suffit pour activer ce magma inté-rieur, cette matière psychologique en perpétuelle formation
« qui se dissimule derrière la monologue intérieur : un foisonnement innombrable de sensations, d’images, de sentiments, de souvenirs, d’impulsions, de petits actes larvés qu’aucun langage intérieur n’explique, qui se
que reprendront ses romans ulté-rieurs.
Mais encore faut-il préciser ce que sont les « tropismes ».
Pour le sens biologique, et en pre-mier lieu le sens premier, un précis de biologie animale nous fournit cette définition:
« une forme de réponse que l’on voit mise en oeuvre chez les animaux peu élevés en organisation, aussi bien chez les plantes, et qui consiste en des attirances ou des répulsions exercées sur l’organisme par certains facteurs externes : ce sont les « tropismes »(9), grâce auxquels se réalise une adaptation instantanée aux excitations perçues par les récepteurs.
Le Dictionnaire Robert donne une bonne et courte définition du tropisme: c’est une « réaction d’orientation et de locomotion d’un organisme soumis à una influence psycho-chimique extérieure ». En d’autres termes, il s’agit des réactions physiques spontannés impercepti-bles -les réflexes- et des mouve-ments indéfinissables d’attirance ou de répulsion, qui glissent très
-
45 Qualitasce qu’il y avait derrière. De-rrière....tout ètait fluide, inmense, sans contours, Tout bougeait à chaque ins-tant, changeait. Impossible de se reconnaître, de rien nommer, de rien classer, impossible de rien juger » (13).
Quoique souterraine, cette vie ca-mouflée fait sentir sa présence « par brusques et fugitifs ébranle-ments qui suffisent à rendre notre tranquillité douteusese » (14).Sans aucun doute, son apport ori-ginal est d’avoir « utilisé le roman pour plonger sous les couches pro-tectrices des clichés afin de met-tre à nu les courants de conscience déjà explorés ». Paradoxale, elle écarte toute vue rétrospective au moment même où elle observe les mouvements psychologiques.
4. Les tropismes en action dans quelques romans
Nous allons analyser dans les premiers romans de Sarraute, l’application des tropismes, en commençant par l’œuvre qui por-te ce nom. Premiers, disons-nous, parce que ceux qui vont suivre chronologiquement en sont en
bousculent aux portes de la conscience, s’assemblent en groupes compacts et surgissent tour à tour, se défont aussitôt, se combinent autrement et réapparaissent sous une nouvelle forme, tandis que continue à se dérouler en nous, pareil au ruban qui s’échappe en crépitant de la fente d’un téléscripteur, le flot ininterrompu des mots »(12).
N. Sarraute suggère par là l’existence, sous des apparences banales, d’un sous-monde doué d’une vie grouillante et frénétique, mu par des instincs organiques et qui serait le monde des rapports des hommes entre eux et avec le milieu.
C’est du reste à ce niveau que Jean-Paul Sartre, préfaçant Portrait d’un inconnu (1949), premier roman de N. Sarraute, écrit : « en peignant l’inauthentique, elle atteint par delà la psychologie la réalité hu-maine dans son existence même ».
Cette réalité instable bouge mais ne se montre cependant jamais.
« Pas un défaut dans la dure et lisse paroi. Pas mo-yen pour les autres de voir
-
46Castro
le système du discours: déictique (emploi de la première personne), présent de l’énonciation : les pre-mières phrases sont nominales d’où un lien avec une certaine oralité : Il s’agit d’une structure d’un mono-logue de conscience : Il n’y a jamais d’identification : les pronoms « ils », « elles » sont « anonymes » : le personnage est un effet de voix.
On dirait que Sarraute tenait à montrer en quoi consistent les tro-pismes avant de les appliquer aux relations humaines dans ses œu-vres ultérieures. Tropismes serait alors une œuvre d’introduction, tous les autres ouvrages suivants reprenant le même thème.
Dans Portrait d’un inconnu (1948), -selon Sartre « un antiroman qui se lit comme un roman policier »- l’auteur demeure assez proche de la négation du traditionnel. Il n’y a pratiquement pas d’anecdote : un avare tyrannique rend impossible la vie de sa fille. Autour d’eux se trouve un monde sans importan-ce, de petits esprits. Ni le père, ni la fille, ni même Dumontet, le seul personnage cité, n’ont des contours bien délimités. Seules les réactions provoquées en eux cons-tituent l’oeuvre : l’anecdote n’est
quelque sorte une répétition en ce qui concerne le style et l’application des concepts sur la création roma-nesque, basée sur les «tropismes». Tropismes est un ensemble de 24 nouvelles tout à fait indépen-dantes. Il y a, entre autres, la pa-tronne qui gronde ses locataires et les domestiques toute la journée, confond vétilles et problèmes im-portants. Ou encore les femmes qui papotent autour d’une tasse de thé…
Tout le livre traite du papotage, de conversations que l’on échange bourrées de clichés. Ces clichés ne sont autres que l’expression des tropismes, ces infimes particules en mouvement qui affleurent sur le champ de la conscience pour disparaître aussitôt. Pour ce faire, N. Sarraute a choisi de déperson-naliser totalement son ouvrage. Nous n’y reconnaissons aucun être, pas de caractères définis non plus. L’intrigue est inexistante, seul l’état mental des êtres intéresse l’auteur. Cette oeuvre se définit comme une ouvre limite, extrémiste, où l’auteur se refuse à toute concession.
Le texte est, en effet, aux antipo-des du roman balzacien. On note
-
47 Qualitastionneles évidents et inevitables.
Dans ces trois oeuvres du début, trône le narrateur qui s’exprime à la première personne. Tout nous est révélé en fonction et par ra-pport à ce narrateur hypersensi-ble. Il est toujours présent et tente de s’insinuer même dans les pen-sées secrètes des autres person-nages pour nous transmettre leur disposition psychologique aussitôt et simultanément.
Mais dans le Planétarium, N. Sarraute tente d’autres moyens pour fouiller le bouillonnement de l’infraconscient de ce grand écrivain académique incarnée par Germaine Lemaire.
Elle reprend le titre du livre annon-cé « en préparation » en 1939. Ti-tre tout aussi symbolique : dans cet univers de faux-semblants, tout est tropiesmes : N. Sarraute se substi-tue aux personnages, qui se voient comme des « personnages » ; cést la création à l’état naissant, qui est en réalité le sujet central du récit. Il s’applique ici à une vieille femme obsédée par la décoration de son appartement que chez le roman-cier en puissance que l’on devine chez son neveu, face à la caricatu-re de grand écrivain académique
que le support de la chasse aux tropismes.
De même Martereau (1953), reste fidèle à l’optique première de son auteur. Les moyens utilisés son in-changés, l’aspect traditionnel très réduit. Ironiquement, la vedette est un faux héros qui encombre l’imagination d’un narrateur désoc-cupé. Cependant beaucoup consi-dèrent Martereau comme la mei-lleure application par N. Sarraute des règles théoriques qu’elle a énoncées. À défaut de disparaître, le personnage évolue.
Ecrit à la première personne mar-terreau est un texte important pour illustrer la configuration du sujet sarrautien ...l’indédicsion, le ralentissement et la répétition -autant de procédés qui résultent du choix d’une narration homodié-gétique. Ces traits caractéristiques sont tous révélateurs de la façon dont le sujet essaie de se saisir en se définissant par rapport à l’autre (15).
Il est évident que même dans Mar-tereau, l’anecdote reste insigni-fiante. Mais par rapport aux pre-mières publications, elle tend vers plus d’objectivité. C’est-à-dire que l’auteur attribue une part de con-sidération à quelques traits tradi-
-
48Castro
le monde: elle est aussi inquiète que tante Berthe, aussi peu cer-taine qu’Alain: pour N. Sarraute, seule la carapace extérieure tend à diversifier les êtres. En revanche, la sous-conscience, le monde des tropismes, est anonyme et plus vé-ritable, il est en outre, selon Sartre, la « substance vivante » d’un long travail d’exploration. Enfin, nous reconnaissons que « dan le Plané-tarium, N. Sarraute demeure plus que jamais à la recherche immobi-le et patiente de la vérité inconfor-table » (17).
Conclusión
C’est pourquoi le relevé des ca-ractéristiques physiques, psycho-logiques est peu étoffé. Les per-sonnages n’aboutissent à aucune connaissance nouvelle chez N. Sarraute : tout est dit dès le dé-but de l’oeuvre. On peut suppo-ser que chacun de nos sentiments n’apparaît dans le champ de la conscience que provoqué par un stimulus déterminé. Ce stimulus déclencherait une réaction com-mune à tous. N. Sarraute semble le croire, puisque, depuis Tropis-mes son objectif principal n’a pas changé.
incarnée par Germaine Lemaire (16)
Cependant il y à première vue une évolution dans la « manière » de l’auteur :
• les personnages sont nom-mément cités et possédent certaines particularités psy-chologiques
• l’anecdote est plus cohérente.
Enfin, N. Sarraute choisit les traits traditionnels pour servir de fonde-ment à ses recherches. Ce chan-gement de procédés marque une étape importante dans l’évolution de l’auteur. Mais qu’on y prenne garde : il ne s’agit nullement de modifier l’optique de l’oeuvre.
N. Sarraute montre que les élé-ments statiques relevant tous du domaine de la psychologie tradi-tionnelle ne sont plus en mesure de répondre aux exigences actue-lles. Pour le prouver, elle utilise les caractéristiques anciennes pour mieux les détruire. Par exemple, l’un des personnages, Germai-ne Lemaire conserve dans tout le roman une certaine particulari-té: elle est spirituelle, cultivée et trône au-dessus de tous les petits sentiments qu’éprouve le commun des hommes. Elle est comme tout
-
49 Qualitasétudes de chimie et d’histoire à Oxfort, puis de sociologie à Berlin et enfin de droit à Paris. A côté de cette formation académique, elle écrit ses premiers essais qui ve-rront le jour en 1939 sous le nom de Tropismes. 1948 est l’année de parution de Portrait d’un inconnu avec une préface de Jean-Paul Sar-tre. En 1953, Martereau s’adresse à un public plus grand.En 1956, c’est la parution de L’Ère du soupçon, qui est un ensemble d’essais contre le roman tradition-nel. En 1959, Le Planétarium rem-porte un grand succès. Viennent ensuite Les Fruits d’or (1963), Le Si-lence (1964), Entre la vie et la mort (1968), Vous les entendez (1972), C’est beau (1975), Enfance (1983), Tu ne t’aimes pas (1988), Ici(1995).Nathalie Sarraute meurt en 1999 à Paris.
(2) Sartre, Jean-Paul, préface à Portrait d’un inconnu. Paris, Coll. 10/18, p.7.(3) Magny, (de) Oliviér, « Nathalie Sarraute ou l’astronomie intérieure », Paris, post-face à Portrait d’un Inconnu, coll. 10/18, p. 228.(4)Sarraute Nathalie, 1963, Nouveau Roman et Réalité, in Revue de l’Institut de sociologie, p. 436.(5) Sarraute, N. l’Ère du soupçon, p. 76.
Même dans les oeuvres ultérieures, Les Fruit d’Or (1963) et Entre la Vie et la Mort (1968), N. Sarraute res-te fidèle à ses idées premières. Si les moyens varient, il s’agit toujo-urs de transcrire l’état mental des êtres: elle a dépersonnalisé le na-rrateur, utilisé les personnages, les situations, exploité les relations entre les hommes, mais elle a con-solidé sa position, confirmé sa con-viction.
Literatura citada
Notes et citations reprises dans l’article
(1) Biographie de Nathalie Sarrau-te (1900-1999)Il convient, croyons-nous- esquis-ser une bréve biographie de notre auteur, naturellement peu connue et lue en notre milieu.Une vocation tardive ? A considé-rer seulement le déroulement su-perficiel de son existence, celle-ci apparaît divisée par une coupure qui la divise en deux : jusqu’ à lâge de 40 ans, Nathalie Sarraute, tout en s’essayant à des textes littéraires, est inscrite au barreau de Paris, d’où elle sera radiée en 1941 par les autorités nazies à cause de ses origines juives. Née en 1900 en Russie, elle fait des
-
50Castro
• Martereau, 18 mai 1953, Pa-ris, Gallimard.
• L’ère du soupçon, 1956, Paris, Gallimard (coll. “Les Essais LXXX”).
• Tropismes, 15 mars 1957, Paris, Éditions de Minuit (Suppression d’un texte de l’E.O. de 1939 et ajout de six nouveaux).
• Le planétarium, 13 mai 1959, Paris, Gallimard.
• La littérature aujourd’hui, 1962, Paris, in Tel Quel, No 9,
• « Nouveau Roman et réalité », 1963, in Revue de l’Institut de Sociologie, Bruxelles, pp. 431-441
• Les Fruits d’or, 1963, Paris, Ga-llimard. Prix international de littérature.
• Le mensonge, 1967, Paris, Gallimard.
• Entre la vie et la mort, 1968, Paris, Gallimard.
• Isma ou Ce qui s’appelle rien suivi de Le silence et Le mensonge, 1970, Paris, Ga-llimard (coll. “Le Manteau d’Arlequin”).
• Vous les entendez ?, 1972, Pa-ris, Gallimard (coll. “Le Che-min”).
• “disent les imbéciles”, 2 sept-embre 1976, Paris, Gallimard.
(7) Wikipedia, Nathalie Sarraute(8) Sartre, Jean-Paul, préface à Por-trait d’un Inconnu, Paris, col. 10/18, p.7(9) Aron, m, et Grasse, p,1966, Pré-cis de biologie animale, Paris, Mas-son et Cie, pp. 572-573)(10) Sarraute, Nathalie, L’Ere du soupçon, Paris, Gallimard, pp. 96-97(11) Sartre. J.P., préface à Portrait d’un inconnu(12) Sarraute, Nathalie, L’ère du soupçon(13) Sarraute, Nathalie, 1959, Le Planétarium, Paris, Gallimard, p.70).(14) Pingaud, bernard, déc. 1963 Le personnage dans l’oeuvre de Natha-lie Sarraute, in Preuves, Paris, p. 20.(15) Peña, Jorge, Etique et esthétique dans l’ouvre de Nathalie Sarraute, in Fabula.org/revue/document 4315.php(16) www.Institutfrançais.com(17) Janvier, Ludovic, 1964, Une pa-role Exigeante, Le Nouveau Roman, p. 85
Ceuvres de Nathalie Sarraute
• Tropismes, 1939, Paris, De-noël.
• Portrait d’un inconnu, 1949, Paris, Robert Marin.
-
51 Qualitas• Théâtre contenant Elle est là
(E.O.), Le Mensonge, Isma 18 octobre 1978, Paris, Gallimard.
• L’usage de la parole, 1980, Pa-ris, Gallimard.
• Pour un oui ou pour un non, 1982, Paris, Gallimard.
• Enfance, 1983, Paris, Galli-mard.
• Paul Valéry et l’enfant d’éléphant suivi de Flaubert le précurseur, 1986, Paris, Gallimard.
• Tu ne t’aimes pas, 1989, Pa-ris, Gallimard.
• Ici, 1995, Paris, Gallimard. • Ceuvres complètes, 1996, Pa-
ris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).
• Ouvrez, 1997, Paris, Gallimard.
Ouvrages et Articles sur Nathalie Sarraute
Aury, Dominique, 1959, Nathalie Sarraute : le Planétarium, in La Nouvelle Revue Française, Paris, No 79, pp. 136-137Bourdet, Denise, Nathalie Sarrau-te, in La Revue de Paris, 65e année, No 6, pp. 127-136Cagnon, Maurice, 1967, Le Planétarium : quelques aspects stylistiques, in French Review, pp. 620-626Finas, Lucette, 1955, Nathalie
Sarraute ou les métamorphoses du verbe, in Tel Quel, Paris, No 20, , pp. 89-103Hudry, Colette, janvier 1954, Na-thalie Sarraute : Communication et Reconnaissance, X, Paris, no 80, pp. 14-19Micha, Reneé, Nathalie Sarraute, 1966, Paris, Classiques du XXe siè-cle, éd. Universitaires, 127 p.Nathan, Monique, 1959, Nathalie Sarraute : le Planétarium, in Cri-tique, Tome XV, No 147-148, pp. 805-806Picon, Gaëtan, juillet 1959, Paris, Le Planétarium, in Mercure de France, No1151, pp. 491-494Plard, Henri, Bruxelles, Novembre 1961, Apologie de Nathalie Sarraute, in La Revue Générale Belge, pp. 1-23Valter, Jean, 1963-1964, Sarraute Nathalie – Les Fruits d’Or, in The French Review, t. XXXVII, pp. 122-124Watson, Williams, 1964, Etude du Planétarium, in Essays en French li-terature, N 1, pp. 89-103Zelnert, Garda, 1962, Paris, Na-thalie Sarraute et l’impossible réalisme, in Mercure de France, No 1188, pp. 593-608
Ouvrages sur le Nouveau Roman (en français)
Alexandre, Didier, 2000, Lire le
-
52Castro
ce, La Pensée UniversitaireJanvier, Ludovic, 1964, Une parole
exigeante. Le Nouveau Roman, Mansuy, Michel (ed.), 1971, Posi-
tions et Oppositions sur le ro-man contemporain, Actes du colloque de Strasbourg (avril 1970), Paris,
Michel, Bloch-Michel, Jean, 1963, Le présent de l’indicatif, Essai sur le Nouveau
Murcia, Claude, 1998, Nouveau ro-man, nouveau cinéma, Paris, Nathan.
Oliver, Annie, « Cinéma et Nouveau Roman. Modifications du re-gard », Micromégas, vol. 24, nº 65-66, pp. 151-67.
Oriol-Boyer, Claudette, 1990, Nouveau Roman et discours critique, Grenoble, Ellug.
Pingaud, Bernard, 1958, « Le Ro-man et le miroir », in Argu-ments, n° 6, pp. 2-5.
Raillard, Georges, 1968, Butor, Pa-ris, Gallimard.
Ricardou, Jean, 1967, Problèmes du Nouveau Roman, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel ».
Robbe-Gruillet, Alain, Pour un Nouveau Roman, Paris, Galli-mard, Coll. « idées »,
Thoraval, Jean, Nicole Bothorel et Francine Dugast, 1976, Les Nouveaux Romanciers, Paris, Bordas, coll. « Études ».
nouveau roman, Paris, Dunod.Allemand, Roger-Michel, 1996, Le
Nouveau Roman, Paris, Ellip-ses, coll. « Thèmes & études ».
Arnaudies, Annie, 1974, Le Nouveau Roman, Paris, Hatier, coll. « The-ma-anthologie.
Astier, P.A.1968, Encyclopédie du Nouveau Roman, Paris, Nouve-lles Editions Debressem.
Boisdeffre, Pierre de, 1967, La ca-fetière est sur la table ou Con-tre le “Nouveau Roman”, Pa-ris, La Table ronde.
Butor, Michel, 1968, Essais sur le roman, Paris, Gallimard, Coll. Idées,
Dugast-Portes, Francine, 2001, Le Nouveau Roman, une césure dans l’histoire du récit, Paris, Nathan Université, coll. «fac. littérature».
Encyclopaedia Universalis, 1996, corpus 20 : Pierre-Louis REY, « Roman - F. Le nouveau roman », pp. 140-3.
Foucault, Michel, « Distance, as-pect, origine », Critique, n° 198, novembre 1963, pp. 931-45; repris in 1968 : Tel Quel. Théo-rie d’ensemble, Paris, Seuil, pp. 11-24.
Gastaut-Charpy, 1966, Le Nouveau Roman : essai de la définition et de situation, Aix-en-Proven-
-
53 Qualitas5.www.universalis.fr/.../roman-le-nouveau-roman/ - On groupe sous l’expression « nouveau roman » des œuvres pu-bliées en France à partir des années 1950 et qui ont eu en commun un refus des catégories établies 6.www.uottawa.ca/academic/arts/.../art0010.htm Ce choix élimine d’emblée un grand nombre de possibilités, le Nouveau Roman jouissant aujourd’hui sur le Web d’une renommée mondiale7.www.etudes-litteraires.com/...style/nouveau-roman.php - Définition du nouveau roman. Nouveau roman et nouveaux ro-manciers : Sarraute, Robbe-Grillet, etc.8.www.etudes-litteraires.com/sarrau-te-biographie.php#ixzz1Q7pOmYufArticle intéressant sur la vie de N. Sarraute9.www.ranker.com/list/nathalie-sarraute-books.../reference 9 Jul 2010 – Nathalie. Sarraute biblio-graphy includes all books by Na-thalie. Sarraute. 10.www.akkani.com/biographie/SARRAUTE-Nathalie.html Biographie de Nathalie Sarrau-te Nathalie Sarraute sur alalettre site dédié à la littérature, ... http://www.evene.fr/celebre/biogra-phie/nathalie-sa...php 11.www.republique-des-lettres.
Wolf, Nelly, 1995, Une littératu-re sans histoire. Essai sur le Nouveau Roman, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire », vol. 342.
Bibliographie sur Internet
1.fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_roman Définition – Une nouveauté relati-ve – Quelques « nouveaux roman-ciers »2 .w w w. s i t e - m a g i s t e r. c o m /nouvrom.htm l’expression « Nouveau Roman » est due à Émile Henriot qui l’employa dans un article du Monde, le 22 mai 1957, pour ren-dre compte de La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet3 .w w w 0 . h k u . h k / f r e n c h / . . . /lang3035_nouveau_roman.htm A cette époque, Robbe-Grillet est déjà considéré comme l’initiateur et le théoricien du Nouveau Ro-man, dont il définit le cadre dans son fameux recueil Pour un Nouveau Roman4.www.espacefranca is .com/nouveauroman.html - Le Nouveau Roman, expression désignant les œuvres d’un groupe d’écrivains français, publiées dans les années cinquante par Jérôme Lindon aux Éditions de Minuit
-
54Castro
fr/11488-nathalie-sarraute.php11 juil. 2011 – Biographie : qui est Nathalie Sarraute ? Nathalie Sarraute. www.cengage.com/.../course_products_wp.pl?... Biographie et bibliographie de Na-thalie Sarraute. http://alalettre.com ... et Jim François Truffaut » 12. www.books.google.com › Lite-rary Criticism › European › Gene-ral.Nathalie Sarraute (1900-1999) is re-garded as one of the major French novelists of the twentieth century. Ini-tially hailed as a leading theorist and exemplar .www.dicocitations.com/auteur/.../Sarraute_Nathalie 77 citations de Nathalie Sarraute. Le meilleur des citations de Nathalie Sarraute ... Cita-tion, Proverbe et biographie Ecrivain français (1900-1999). 13. www.encyclopedia.com › ... › French Literature: Biographies – Na-thalie Sarraute, 1900-1999, French novelist, b. ... Nathalie Sarraute (born 1900) was one of the seminal figures in the emergence .... Pick a style be-low, and copy the text for your biblio-graphy 14.www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/.../art0010.htm Une simple recherche un moteur tel que Google fournit plus de vingt-neuf
mille ... Robert Pinget fait, lui, l’objet d’une biographiehttp://15. www.ccic- Nathalie Sarraute oc-cupe, elle aussi, une place de choix sur le Web, Cerisy , le programme 2004cerisy.asso.fr/programme2004.html.


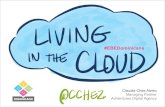





![Exposicion la vara de aarón florece [autoguardado]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/55661cbdd8b42a61238b472f/exposicion-la-vara-de-aaron-florece-autoguardado.jpg)