PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL...Marie Lambert-Chan inscrit un guide pour étudiants Page 4...
Transcript of PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL...Marie Lambert-Chan inscrit un guide pour étudiants Page 4...

Antoine DelBusso navigueentre «papier» et «Toile» Page 2
EDIT IONPRESSES DE L ’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Marie Lambert-Chan inscrit un guide pourétudiants Page 4
Benoît Melançonet «qui faitquoi»dans lemondeuniversitaire Page 5
C A H I E R S P É C I A L I › L E D E V O I R , L E S S A M E D I 2 7 E T D I M A N C H E 2 8 O C T O B R E 2 0 1 2
Cette année, les Presses de l’Université de Montréal (PUM) souf flent leurs cinquante chan-delles. Ayant fait paraître plus de 1200 titres au cours des cinq dernières décennies, elles sontreconnues pour produire des ouvrages savants d’exception. Antoine Del Busso, éditeur, et Be-noît Melançon, directeur scientifique, expliquent comment cette toute petite maison d’éditionspécialisée parvient à produire des dizaines de livres et de revues de qualité chaque année.
«Notre rôle, c’est de diffuser le savoir»Et 1200 titres plus tard, les PUM sont cinquantenaires
É M I L I E C O R R I V E A U
F ondées en 1962, les PUM ont pourmandat principal de dif fuser les ré-sultats de la recherche universitaireet de transférer des connaissancesscientifiques au public, que ce soit
par le biais de livres, de revues savantes ou dematériel électronique. Bien qu’elles aient pu-blié plus d’un millier de livres depuis leurs dé-buts, le catalogue des presses compte environ500 titres actifs.
«On publie de 35 à 40 titres par année, préciseM. Del Busso. À cela s’ajoutent de 10 à 15 numé-ros de revue. Tout cela est aujourd’hui produit ennumérique. Le reste du catalogue est constitué delivres qui n’ont jamais été réédités.»
Une nature particulièreDe par la nature des ouvrages qui sont publiés
aux PUM, les tâches des éditeurs et du directeurscientifique qui y travaillent ne sont pas tout à faitles mêmes que celles qu’on pourrait leur confierau sein de maisons d’édition généralistes.
«La différence, aux PUM, c’est qu’on travaillesur des sujets souvent plus pointus et qu’on faitdes livres plus compliqués. Un éditeur généralistese charge du texte et parfois d’illustrations. Nous,dès qu’on travaille avec un auteur, ça impliquedu texte, des illustrations, des graphiques, des bio-graphies, des notes. Nos livres les plus savantssont accompagnés d’un appareil qui nécessite uneexpertise particulière», souligne M. Melançon.
Cette expertise, M. Del Busso et M. Melan-çon l’ont développée au fil des ans en compa-gnie d’une toute petite équipe, laquelle estconstituée de deux éditrices maison, d’une di-rectrice de la production, d’une directrice de lapromotion et d’un responsable du service à laclientèle et des abonnés.
Bien qu’elle soit chargée d’examiner et de pu-blier des textes très spécialisés, l’équipe desPUM est surtout composée d’individus ayant unbagage généraliste. «Les gens qui travaillent icisont d’abord agiles et polyvalents, soutientM. Melançon. Une journée, ils sont appelés à tra-vailler sur un livre de criminologie, le lendemain,ils en font un sur la médecine. Ce ne sont pas desspécialistes de linguistique, de criminologie ou depharmacologie ; ce sont des éditeurs scientifiquesqui travaillent en collaboration avec des spécia-listes. L’intérêt d’avoir des éditeurs généralistes,c’est qu’ils regardent tout cela de l’extérieur.»
«Nous veillons tout de même à ce que nos édi-teurs soient intéressés par les sujets des livres surlesquels ils travaillent, ajoute M. Del Busso.Nous ne demanderons pas à un éditeur qui nes’intéresse absolument pas à la mycologie de tra-vailler sur un livre qui traite de champignons.Nous sommes attentifs à cela. »
Une question de contenu…Puisqu’ils ne peuvent s’appuyer unique-
ment sur leurs connaissances pour juger de lavaleur scientifique des textes qu’on leur pro-pose, les éditeurs des PUM doivent faire ap-pel à des collaborateurs extérieurs spéciali-sés. En général, tous les projets sont soumis àl ’analyse de deux spécialistes dont onconserve toujours l’anonymat, mais, selon lesouvrages, le mode d’évaluation par les pairspeut varier.
« Par exemple, on ne fonctionne pas de lamême façon lorsqu’on évalue un ouvrage collectifque lorsqu’on évalue le texte d’un auteur unique.Chose certaine, l’évaluation par les pairs consti-tue toujours un moment d’un dialogue ; un dia-
logue qui débute entre l’auteur et l’éditeur, puisqui se poursuit entre l’éditeur et l’expert et qui seconclut entre l’auteur et l’éditeur. On reçoit par-fois des rapports très longs et très détaillés desspécialistes avec qui on collabore, mais ça nousest immensément utile ! C’est plus long que d’édi-ter un livre régulier, mais c’est ce qui assure le sé-rieux des presses universitaires » , soutientM. Melançon.
… et de contenant !Une fois qu’ils ont la conviction que le
contenu des livres qu’ils comptent publier estréellement de grande qualité, les éditeurs desPUM doivent s’assurer que le contenant qu’ilsont choisi pour le véhiculer est bel et bien leplus approprié.
«Notre rôle, c’est de dif fuser le savoir, affirmeM. Melançon. Pour qu’il soit bien diffusé, il fauttrouver le bon format et le bon canal. Antoine aune phrase que je passe mon temps à citer ; il ditqu’un éditeur, c’est quelqu’un qui produit uni-quement des prototypes. Son rôle, c’est de trouverpour un livre le bon format, le bon papier, le bontype d’illustration et la meilleure présentation. »
« Mais il faut faire tout cela en étant respec-tueux de ce que l’auteur a voulu faire, complèteM. Del Busso. La pire erreur, c’est de lui fairefaire un livre qu’il ne veut pas faire. Il faut s’ins-crire dans sa logique. Il ne faut pas oublier quenous sommes au service des auteurs, des profs,des chercheurs. Nous sommes importants dans lachaîne de diffusion, mais, sans eux, nous n’avonsrien à diffuser ! »
Une fois le format déterminé, l’éditeur doittrouver le canal de diffusion le mieux adapté autitre en question. Au Canada, les PUM distri-buent leurs publications par l’entremise des li-brairies. En Europe, elles utilisent les servicesde trois distributeurs spécialisés dans les publi-cations universitaires.
« Il faut toujours s’assurer que chaque livretouche son public, dit M. Melançon. Parfois, çaimplique qu’on envoie des exemplaires à certainschercheurs ou à des journalistes spécialisés. Ons’organise pour que le titre se retrouve entre lesbonnes mains. »
En bonne santéMême si elles célèbrent cette année 50 ans
d’ef forts et que le monde de l’édition est enpleine transformation, notamment en raison del’émergence du numérique, les PUM sont loind’avoir le souf fle cour t. Alors qu’aux États-Unis, confrontées aux géantes que sont Har-vard, Oxford ou Cambridge, de nombreusespetites presses universitaires ferment leursportes chaque année, comme la plupart despresses universitaires canadiennes, les PUM seportent plutôt bien.
« Tout n’est pas rose, mais on est moins me-nacé, parce qu’ici il y a une volonté importantede la part des universités de maintenir les pressesuniversitaires en bonne santé, confirme M. Me-lançon. Les contacts que nous avons avec la di-rection de l’université montrent bien que, pourelle, les presses sont très importantes. Il faut toutde même être vigilant et réagir aux changementsqui sont en train de se produire, mais, pournous, il ne s’agit pas tant d’une menace que d’unmonde de possibilités. »
Pour consulter le catalogue des PUM :pum.umontreal.ca.
CollaboratriceLe DevoirJA
CQ
UE
S G
RE
NIE
R L
E D
EV
OIR
PUM

É D I T I O NL E D E V O I R , L E S S A M E D I 2 7 E T D I M A N C H E 2 8 O C T O B R E 2 0 1 2I 2
Dans les bureaux des PUM, on a dévoilé auDevoir, dans une atmosphère de franche ca-maraderie, le processus ayant sous-tendu le li-vre Adolescentes anorexiques. Plaidoyer pourune approche clinique humaine, l’un des plusgrands succès en libraire de l’éditeur.
É T I E N N E P L A M O N D O N É M O N D
L’accompagnement, le lien, les mots et letemps. Le Dr Jean Wilkins résume par ces
quatre mots ce qui est important dans sa pratiquemédicale auprès des jeunes anorexiques. NadineTremblay, l’éditrice aux Presses de l’Université deMontréal (PUM) qui est derrière la publication deM. Wilkins, sursaute d’étonnement puis elleajoute aussitôt: «J’allais vous dire que, en édition, ily a le lien, les mots, le temps et l’accompagnement.»
Drôle de départ«C’est un article. Un très bon article. Vous pou-
vez l’envoyer ailleurs. Mais, pour nous, ce n’estpas un livre. » C’est par ces mots que NadineTremblay a d’abord répondu par téléphone auDr Jean Wilkins, après la lecture du manuscritdu médecin tenant en une quarantaine de pages.Puis, après avoir raccroché, elle s’est ravisée. «Jel’ai rappelé immédiatement pour lui dire : “On aun livre. Mais, maintenant, il faut penser à unetable des matières, à un chemin de fer, à une loco-motive avec tous ses wagons”», raconte-t-elle.
Puis, «on s’est rencontré ici. C’était le mardi»,poursuit Jean Wilkins. « Nos fameux mardis »,commente aussitôt Nadine Tremblay. C’est unmardi, justement, dans les bureaux des Pressesde l’Université de Montréal (PUM), que lesdeux complices se remémorent toutes lesétapes ayant mené au livre déposé sur la table,à une photographie de jeune fille au regardfrondeur en page frontispice.
D’ailleurs, si l’auteur exerce un contrôle surle contenu, il n’en a généralement aucun sur lacouverture. Mais ici, les recommandations deM. Wilkins ont été suivies à la lettre. « J’avaisdit : “ Je veux des filles qui ont l’air décidées. ”L’anorexique est déterminée dans sa maladie.Puis, je ne voulais pas de photo d’une fille dé-
charnée », se rappelle le pédiatre, très satisfaitde l’enrobage de son ouvrage. L’idée avait étéjugée bonne, confirme Mme Tremblay.
Un livre naîtC’est d’ailleurs pour combler son besoin
d’écrire, mais aussi pour combler un vide dans lalittérature à ce sujet, que le pionnier de la méde-cine de l’adolescence a décidé de prendre laplume. La plupart des livres publiés sur l’anorexieont été rédigés par des psychiatres ou par desanorexiques sous la forme autobiographique.
Fort de ses 37 ans d’expérience où les jeunesanorexiques l’ont constamment poussé vers ledoute, le pédiatre voulait partager ses constatsen clinique et bien analyser ces quatre étapesde la maladie qu’il avait discernées. « C’est unconcept que j’avais moi-même développé, créé etmis sur papier et je faisais beaucoup de confé-rences là-dessus. Mais je ne m’étais jamais ac-cordé le temps de l’étayer davantage pour expri-
mer ce que je rencontrais, observais, pensais. Jene sais pas pourquoi, j’avais toujours cette rete-nue. Et c’est cette retenue qu’on m’a permis ici delâcher et de relâcher pour aller plus loin dans maréflexion. » Il a donc réuni toutes ses notes, sesprésentations multimédias, ses articles scienti-fiques et ses écrits « épars, mais classés » par-tout dans son bureau.
« Je savais qu’il y avait un produit original,mais je savais aussi qu’il fallait que je fignole ça.L’accueil que j’ai eu ici et la rigueur qu’on m’aproposée, ça me plaisait », assure M. Wilkins.Aussitôt, une aide à la rédaction a été fournie àM. Wilkins. Mais il s’est aperçu très tôt que lechoix de la rédactrice scientifique n’était pas ce-lui qui collait le mieux au projet. «Elle était peut-être trop fascinée par le sujet. Elle essayait de com-prendre sous un angle psychiatrique, qui n’étaitpas mon angle à moi», remarque M. Wilkins.
« C’est un obstacle de ne pas avoir la bonnepaire, commente Nadine Tremblay, parce quetravailler avec quelqu’un, c’est, oui, s’entendre defaçon conviviale, mais aussi s’entendre intellec-tuellement, comprendre l’autre, comprendre l’ex-périence, mais en même temps garder le cap. »Après des vacances, les PUM ont décidé de ju-meler le Dr Wilkins avec une autre journalistescientifique : Odile Clerc.
Collaboration utileUne collaboration fructueuse s’est rapide-
ment installée. Elle lui suggérait plusieurs modi-fications qu’il écoutait avec ouverture. «Commeclinicien pris en pratique, j’avais besoin de cet ap-pui. Je ne pense pas qu’on puisse faire ça sansavoir une structure derrière soi. » Odile Clerc luiposait aussi les bonnes questions pour ouvrirles chapitres et pour clarifier sa pensée.
« On me demandait des précisions. C’est çaqui, peut-être, faisait défaut chez moi : arriveravec des précisions sur des images que je pouvaisavoir de la maladie. On m’a permis de mettre çaen très bon français, aussi. Et on travaillait.J’écrivais. Odile le relisait. On se questionnait. Jele réécrivais une autre fois. Et, une fois que toutça était terminé, on allait vers Nadine, qui re-voyait le tout », explique M. Wilkins.
« Moi, je posais des questions pour un publicnon averti, c’est-à-dire un public curieux, ajoute
Mme Tremblay, parce que notre but, ce n’étaitpas de la vulgarisation simple, c’était de rendreaccessible l’information. » C’est d’ailleurs pourélargir l’auditoire le plus possible, pour rendrele propos facile d’approche, tant pour des inter-venants que pour des parents ou des patients,que le livre comporte peu de références, peude notes en bas de page.
Et M. Wilkins a apprécié cette applicationpour le choix des mots. « Toute ma vie, j’aipensé comme ça : oui à un discours scientifique,mais il faut avoir un discours humain. Il fautavoir un discours que les gens comprennent pourêtre utile. » Les commentaires que reçoitM. Wilkins, de la part de parents se disant ras-surés après la lecture de son livre, semblentprouver le succès de l’opération.
Un an, soit une période ni trop courte ni troplongue pour garder la motivation intactejusqu’au bout, a été nécessaire pour en arriverau résultat final. « Ils ont occupé beaucoup demes fins de semaine», lance M. Wilkins, qui nepouvait pas mettre une pause à ses obligationscliniques. N’empêche, il a mis les ef for ts etconsacré le temps nécessaire. « Je pense quej’avais une responsabilité à définir ce qu’est lamédecine de l’adolescence, ce qu’on a constaté, cequ’on peut faire. On a cette responsabilité decomprendre, de faire les recherches et de trans-mettre notre savoir », dit-il, en incluant tous lescliniciens de sa génération qui ont bâti des dis-ciplines de la médecine.
«J’espère que des collègues lâcheront un peu lesrevues ultrascientifiques pour aller vers quelquechose d’un peu plus transcendant et plus synthé-tique sur notre histoire», lâche-t-il. D’ailleurs, sonami André Robidoux, titulaire de la Chaire de re-cherche en diagnostic et traitement du cancer dusein, a été fasciné par son ouvrage et s’attelle ac-tuellement, dans une démarche semblable avecles PUM, à un livre à propos de sa spécialité.
«Quand on vieillit, le temps presse. Il faut se dé-pêcher et s’arrêter. On a une contribution à faire.J’ai des amis qui ont passé leur vie et leur carrièresur une maladie. C’est important qu’il y ait unesynthèse qui sorte de ça», insiste M. Wilkins.
CollaborateurLe Devoir
SUCCÈS ÉDITORIAL
Et l’anorexie fut mise en mots
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Du papier à la toile« Le numérique est un complément de notre travail »
É M I L I E C O R R I V E A U
C e n’est pas d’hier que da-tent les ef forts des PUM
pour passer au numérique.Comme le souligne M. An-toine Del Busso, éditeur desPUM, « elles ont beaucoup tâ-tonné » ! En 1998, alors qu’In-ternet était loin d’être aussidéveloppé qu’aujourd’hui,elles ont mis sur pied le siteInternet Érudit. Donnant sur-tout accès à des revues et àquelques livres en format nu-mérique, il permet encore au-jourd’hui de diffuser et de pro-mouvoir les résultats de la re-cherche universitaire.
La plateforme d’Ér uditn’étant pas adaptée à la diffu-sion de tous les contenus pro-duits par les PUM, au débutdes années 2000, elles ontcommencé à développer cer-tains compléments numé-riques, lesquels avaient sur-tout pour objectif de bonifierl’offre en papier.
« Par exemple, si on faisaitun livre sur la profession de
musicologue, dans le web, onpouvait rendre disponibles lesfichiers sonores dont il étaitquestion dans le livre. Ou bien,encore, si on faisait un livre surles zoonoses parasitaires, la bi-bliographie pouvait être miseen ligne. C’était sur tout cegenre de choses que nous fai-sions à l’époque», explique Be-noît Melançon, directeurscientifique des PUM.
Ce n’est toutefois que depuistrois ans que les PUM produi-sent de réels ouvrages en nu-mérique. Ainsi, tous leurs nou-
veaux titres sont rendus dispo-nibles soit en format PDF, soiten format EPUB. Quant aux ti-tres plus anciens, mais tou-jours actifs, ils sont graduelle-ment numérisés puis of fer tsen format PDF.
«C’est une étape plus avancéeque les compléments, mais cen’est qu’une étape intermé-diaire, estime M. Melançon.L’avenir du numérique n’est paslà. Il ne s’agit pas de faire desPDF ou des EPUB et de les met-tre en ligne. Nous souhaitons al-ler beaucoup plus loin que ça.»
Pas de recette uniqueLe hic, c’est qu’il n’y a pas de
recette unique en matière denumérique. Les combinaisonssont multiples, tout comme lesformats. Il est donc difficile dedéterminer la meilleure for-mule pour dif fuser un livredont le contenu ne se limitepas qu’au texte.
« La nature des livres quenous publions complexifie beau-coup la tâche. Ils contiennentsouvent des tableaux, des illus-
trations, etc. Il fautque tout ça soit lisible,que ça rentre dans lecadre de la page. C’estpour ça qu’il n’y a pasqu’une solution ! Parexemple, il y a certainsde nos livres qui se-raient plus pratiquescomme sites web quecomme document PDF
ou EPUB. Des livres quicontiennent 1500 pages, avecdes tableaux, des graphiques, desimages, lire ça sur un Iphone, cen’est pas très convivial. C’estpour ça qu’on fait des sites Inter-net avec certains de nos titres»,souligne M. Melançon.
Parce qu’elles peuvent se lepermettre en raison de leurtaille modeste, les PUM ontdonc décidé d’y aller cas parcas. Chaque ouvrage est uniqueet commande un type particu-lier de passage au numérique.Tous se retrouvent désormais
dans la Toile, mais certains y fi-gurent en PDF, d’autres en for-mat EPUB et quelques-unssous forme de sites Internet.
«D’ici peu, nous aurons égale-ment des titres qui ne seront dis-ponibles qu’en format numé-rique, annonce M. Del Busso.Par exemple, nous préparonsune collection des œuvres iné-dites de Germaine Guèvremont,qui sont très intéressantes pourl’histoire littéraire. Une versioncritique a déjà été faite. Nousn’aurons pas de version de pa-pier, parce qu’elle s’adressepresque uniquement aux cher-cheurs. Mais nous pensons qu’ilest important de rendre cette col-lection disponible aux gens quidésirent la consulter.»
CommercialisationOutre l’adaptation technolo-
gique qu’impose le passage aunumérique, celui-ci supposeégalement de nouvelles façonsde faire en matière de com-mercialisation. Aussi, crai-gnant que les investissementsnécessaires pour conver tir
leurs catalogues en différentsformats ne diminuent leursprofits, plusieurs éditeurs semontrent encore hésitants en-vers le numérique. Ce n’est ab-solument pas le cas aux PUM.
« Pour nous, le numérique,c’est un complément de notre tra-vail. On n’est pas du tout dansune logique de crainte, soutientM. Melançon. Notre travail,c’est de dif fuser du savoir, et,pour diffuser du savoir, il y a descanaux différents. Le numériqueest l’un de ceux-là et il a beau-coup de potentiel!»
Ainsi, contrairement à la plu-part des éditeurs qui vendentleurs ouvrages numériques àenviron 75 % du montant desversions en papier, les PUMont choisi d’of frir les leurs àseulement la moitié du prix.« Ça nous paraît juste et nousne perdons pas d’argent »,confie M. Del Busso.
La plupar t des titres desPUM disponibles en formatnumérique ne comprennentpas non plus une protectionpar ticulière. « Nos livres ne
sont pas verrouillés. Noussommes là pour dif fuser le sa-voir, nous ne sommes pas làpour mettre des verrous sur desverrous pour empêcher que noslivres soient lus. Il faut biencomprendre qu’on s’adresse àdes spécialistes. Soyons francs,l’intérêt pour les copies piratéesn’est pas le même pour les zoo-noses parasitaires que pour 50Shades of Grey », lance d’unton moqueur le directeurscientifique.
Et qu’en pensent les au-teurs ? Sont-ils prêts à rendreleurs œuvres disponibles à lagrandeur de la planète enquelques clics seulement? Auxdires de M. Del Busso, ceux-cise montrent de plus en plus en-thousiastes lorsqu’on leur parlede distribution numérique.
« La réaction de nos auteursenvers le numérique est au-jourd’hui beaucoup plus positivequ’elle ne l’était il y a trois ans àpeine. Auparavant, si je disais“votre livre va être diffusé dansle web ”, le premier réflexe,c’était de se montrer inquiet, no-
tamment pour les droits. Au-jourd’hui, ils sont contents queleurs livres soient aussi dif fusésvia la Toile», affirme l’éditeur.
La fin du papier?Si davantage d’auteurs se
montrent enthousiastes àl’idée de dif fuser leurs ou-vrages via Internet et quel’avancement des technologiesfacilite chaque jour le passageau numérique, d’après M. DelBusso et M. Melançon, le jouroù les livres savants ne serontplus publiés en format de pa-pier est loin d’être arrivé.
«On va continuer à faire dupapier, pour la simple et bonneraison que les livres ont encoreleur raison d’être, assureM. Melançon. Il ne faut pas êtrerétrograde et opposer les deuxmodèles ; ils sont complémen-taires. Il faut le voir comme unebelle occasion, comme la possibi-lité de diffuser le savoir là où iln’était pas accessible !»
CollaboratriceLe Devoir
Comprenant près de 500 titres actifs en format papier, le cata-logue des Presses de l’Université de Montréal (PUM) encompte presque autant en format numérique. Ayant entaméun virage technologique il y a quelques années déjà, la maisond’édition spécialisée parvient aujourd’hui à dif fuser ses ou-vrages à caractère scientifique de façon ef ficace sur la Toile.
ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR
Au centre, Antoine Del Busso, éditeur des PUM, et Benoît Melançon, directeur scientifique des PUM, sont entourés de leur équipe.
ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR
Le Dr Jean Wilkins, fort de son expérience avecles jeunes anorexiques, voulait partager sesconstats en clinique par l’écriture.
«Notre travail, c’est de diffuser dusavoir et, pour diffuser du savoir, il y a des canaux différents. Le numérique est l’un de ceux-là et il a beaucoup de potentiel !»

É D I T I O NL E D E V O I R , L E S S A M E D I 2 7 E T D I M A N C H E 2 8 O C T O B R E 2 0 1 2 I 3
DANS LES ANNÉES CINQUANTE
«Les presses universitaires sont venues combler un vide»
H É L È N E R O U L O T - G A N Z M A N N
Àl’époque, le Québec s’ouvreaux publications savantes :
les Presses universitaires de La-val en 1955, des projets à McGilldans les années 50 également.«Il y avait le désir d’augmenterles publications savantes, d’au-tant que, dans les années 1940, ily avait eu la commission Massey,mise en place pour étudier le mi-lieu scientifique. Cette commis-sion avait fait des recommanda-tions qui indiquaient que le gou-vernement devrait financer cetype de publication. Sachant qu’ily aurait des montants de finance-ment disponibles, les universitésont commencé à vouloir éditer lesouvrages de leurs professeurs.»
L’autre guerreAutre élément de contexte,
les années 1940, marquées parla Seconde Guerre mondiale.À ce moment-là, toute l’éditionfrançaise est freinée par leconflit. Les éditeurs québécoisreprennent ce marché et com-mencent à publier des ou-vrages scientifiques. « Les édi-tions Fides, entre autres, pu-blient alors des ouvrages desciences humaines, expliquePierre-Luc Beauchamp. Ellessont fondées en 1937, mais, du-rant le conflit, elles sont en forteexpansion parce que le marchéfrançais est fermé et que le mar-ché québécois devient le marchéde l’édition francophone. Quandla guerre se termine, ce marchésemble se refermer et les débou-chés commencent à manquerpour les maisons d’édition qué-bécoises privées, qui ne sont pasen mesure de soutenir des pro-jets d’éditions savantes. Il y aalors un vide que les universitésvont combler en créant leurspropres maisons d’édition, audépart pour publier les ouvragesde leurs propres enseignants.»
Avec le retour de l’éditionfrançaise sur le sol québécois,la donne change. Jusque-là, leséditeurs privés tels que Fideset Beauchemin pouvaient sepermettre de perdre de l’ar-gent en publiant un ouvragescientifique très pointu et se re-faire avec les manuels sco-laires. Avec la réduction desdébouchés, ils ne peuvent toutsimplement plus se le permet-tre. Ils se spécialisent alorsdans certains domaines ou de-viennent des généralistes. Plustard, Beauchemin s’associeramême à Chenelière pour deve-nir exclusivement scolaire.
« Il y avait un trou, il y avaitdu financement disponible quiallait arriver dans les années àvenir, dans le même temps, lesuniversités grandissaient, il yavait de plus en plus de départe-ments, de plus en plus de profes-seurs, mis à part quelques-unsd’entre eux, les plus connus, quipubliaient dans les maisons gé-néralistes ou à l’échelle interna-tionale, ils n’avaient pas de dé-bouchés de publication, ça deve-nait donc une possibilité, voireune nécessité, pour les universi-tés de se lancer dans l’édition. »
Pour professeurs d’abordAu dépar t, il y a donc une
volonté claire de la par t desPresses universitaires deMontréal (PUM) de favoriserla publication des ouvragesdes professeurs de l’université.Dans la première année, huitvolumes sont publiés et cinqou six autres sont sur le pointde l’être. Dix ans plus tard,dans les années 1970, ce sontune trentaine de livres par an.Le budget est limité. Les PUMcomptent sur des donations.Elles reçoivent d’ailleurs200 000 $ d’une fondation aumoment de sa création,qu’elles vont placer.
« On parle d’un budget defonctionnement autour dequelques dizaines de milliers dedollars par an au début », es-time Pierre-Luc Beauchamp.Ainsi, le chif fre d’af faires an-nuel des PUM ne dépasse ja-mais de 7 à 8 % celui de Fidesentre 1962 et 1972. En 1971-1972, les PUM dépensent300000$, dont 50000$ en dons
et subventions, quand le chif-fre d’affaires de Fides s’élève à4,3 millions de dollars. Mais,dès la fin des années 70, alorsque Fides amorce son lent dé-clin, l’écar t se réduit. Lesventes de Fides se montent à1,5 million de dollars en 1978,alors que, la même année, lesPUM font des recettes de500 000 $, seulement trois foismoins. Durant toutes les an-nées 1960, l’une comme l’autre
feront d’ailleurs des déficitspresque chaque année. « LesPUM étaient intégrées à l’Uni-versité de Montréal et il y avaitdu financement public, ex-plique Pierre-Luc Beauchamp,mais ce n’était pas 100 % dubudget et, d’une année à l’autre,
ça n’a pas toujours été facile. »Le créneau des PUM ? Les
mathématiques, la littérature etla critique littéraire, même si lecatalogue reste relativement va-rié. Fides se concentre plus surles sciences humaines, quandles Presses de l’Université La-val se concentrent sur les re-vues et que les Presses del’Université McGill s’attachentà publier les ouvrages des pro-fesseurs anglophones.
Des revuesLes PUM, ce sont également,
dès le départ, des revues scien-tifiques savantes. « Au départ,une revue d’économie, puisjusqu’à cinq ou six correspon-dant à dif férents départementsde l’Université, raconte le docto-rant en histoire. Elles n’ont ce-
pendant pas beaucoupdépassé le cadre desuniversités québé-coises, voire cana-diennes, françaiseségalement, parce qu’ily avait des ententesavec les Presses univer-sitaires de France, lesPUF. Mais on ne peut
pas dire qu’elles ont eu une diffu-sion très étendue et qu’elles ontatteint un grand prestige.»
Alors même que, dès les an-nées 1960, publier aux PUMest un gage de grande rigueurscientifique. Contrairementaux maisons d’édition privées,
le comité d’évaluation desPresses universitaires deMontréal choisit ses titres enfonction de la qualité de l’ou-vrage, et non d’impératifs éco-nomiques. « Cette donne estmalheureusement en train de
changer et les PUM, comme lesautres maisons d’édition liéesaux universités, sont au-jourd’hui à la croisée des che-mins, estime Pierre-Luc Beau-champ. On rationalise de plusen plus et on regarde mainte-
nant le rendement de l’investis-s ement qu ’on e s t en dro i t d’attendre. »
CollaboratriceLe Devoir
Dans l’après-guerre, les maisons d’édition privées se retirentpeu à peu des publications savantes. « Dès 1955-1956, il yavait un projet de maison d’édition en cours à l’Université deMontréal, note Pierre-Luc Beauchamp, doctorant au Départe-ment d’histoire de l’Université McGill, spécialiste des éditionssavantes. Il y a même eu des volumes publiés dans ces an-nées-là, et, en 1962, on of ficialise tout ça. »
SOURCE HISTORIA
Dans les années 1960, les PUM étaient intégrées à l’Université de Montréal et recevaient ainsi unepart de financement public.
Dès les années 1960, publier aux PUM est un gage de granderigueur scientifique

É D I T I O NL E D E V O I R , L E S S A M E D I 2 7 E T D I M A N C H E 2 8 O C T O B R E 2 0 1 2I 4
QUATRE AUTEURS ET LEURS OUVRAGES
Du guide pratique à l’édition de haut vol« Toutes les grandes universités doivent avoir leurs presses »
A S S I A K E T T A N I
T rois chercheurs et une journaliste appré-cient ce que cette maison d’édition peut of-
frir : une dif fusion de proximité avec les étu-diants, une rigueur éditoriale ou encore la pos-sibilité de publier des ouvrages spécialisés mal-gré leur public potentiel restreint.
L’art d’être étudiantEn marge des ouvrages scientifiques écrits
par des chercheurs et destinés aux spécialistes,les Presses de l’Université de Montréal ont faitparaître, au mois d’août 2012, un petit ouvragepas comme les autres : Petit guide de survie desétudiants, écrit par Marie Lambert-Chan et illus-tré par Benoît Gougeon. Dans les coulisses desamphithéâtres, il s’agit ici de l’autre visage desétudes universitaires : celui qui se dessine àcôté des bonnes notes, des cours terminés etdes diplômes obtenus, mais qui peut faire toutela différence dans un parcours universitaire.
En ef fet, être étudiant n’est pas seulementobtenir son diplôme, c’est aussi gérer tout lereste : les finances, l’emploi du temps, la prépa-ration à la vie professionnelle ne s’apprennentpas forcément sur les bancs de l’école, mais ilssont essentiels pour qui veut tirer son épingledu jeu. Un savoir non universitaire auquel denombreux étudiants sont mal préparés, voirecomplètement néophytes.
Journaliste au journal Forum de l’Universitéde Montréal, Marie Lambert-Chan a eu l’occa-sion de croiser nombre d’étudiants en priseavec ces enjeux, qui reviennent d’une année àl’autre et se répètent d’un étudiant à l’autre.C’est pour répondre à ces questions que l’au-teure a conçu ce guide, qui regroupe 42 ru-briques publiées dans le journal Forum pen-dant un an et demi. En 160 pages, elle livre unpetit condensé de conseils et d’astuces pour sefaciliter la vie. Au répertoire : procrastination,angoisse de la page blanche, conciliationétudes-travail-famille, ou encore la préparationaux examens de fin de session à la manièred’athlètes de haut niveau. Pour mieux peaufi-ner ses conseils, Marie Lambert-Chan a fait ap-pel aux nombreux spécialistes qui sont là pouraider les étudiants : orthopédagogues, spécia-listes en finances, psychologues ou conseillersen orientation.
De la chronique au livreEt puisque apprendre à être étudiant s’avère
aussi important que le succès strictement uni-versitaire, on ne s’étonnera pas d’apprendreque ce sont les PUM qui ont contacté la journa-liste pour publier ce recueil. «Avec Benoît Gou-geon, nous avions eu l’idée de proposer le recueilaux PUM, mais elles nous ont devancés ! Lorsquel’éditrice Nadine Tremblay m’a contactée, ellem’a dit que l’équipe des presses suivait avec inté-rêt cette rubrique chaque semaine », expliqueMarie Lambert-Chan.
Comme l’ouvrage se base sur des textes déjàécrits, le travail d’édition s’est concentré surl’adaptation de la chronique au livre, du publicciblé de l’Université de Montréal à unpublic universitaire plus large.«Comme les chroniques du journal Fo-rum étaient adressées aux étudiants del’Université de Montréal, il a fallu lesadapter à l’échelle de la province. À lademande de mon éditrice, j’ai contactédes experts relevant d’universités dif fé-rentes pour avoir d’autres avis et arri-ver à une portée plus universelle. »
L’expérience avec les PUM? « Je n’aique des bons mots », commente MarieLambert-Chan, qui retient la commu-nication et la bonne entente qui ré-gnait avec la maison d’édition. Unecollaboration fructueuse et «une expé-rience très agréable» avec cette «petitefamille », aux dires de l’auteure.
Un guide thérapeutique sur ladouleur
Professeur au Dépar tement depharmacologie de l’Université deMontréal, Pierre Beaulieu a publiédeux livres aux Presses de l’Univer-sité de Montréal : Pharmacologie de la douleur,en 2005, et Précis de pharmacologie, en 2010,comme codirecteur. Il prépare actuellement unguide thérapeutique sur la douleur, à paraîtreen 2013, au terme d’une année entière de re-cherche.
Alors que ses livres précédents étaient desti-nés à un public spécialisé, ce guide thérapeu-tique, plus attractif et plus pratique, s’adresse àtout le monde : « Il vise à aider les médecins, lespharmaciens, mais aussi le personnel infirmier etles étudiants», précise Pierre Beaulieu. Partantdes bases, répondant à toutes les questions etoffrant une démarche synthétique sur la dou-leur, qu’elle soit cancéreuse, chronique, inflam-matoire ou opératoire, l’auteur présente tous lestypes de douleur et de médicament qui existent.
Ce guide est conçu pour offrir une grande fa-cilité d’utilisation et de consultation. Dans cetteoptique, le travail d’édition a privilégié le pra-tique et l’agréable, déployant un travail de pré-cision concernant l’image et les tableaux.«Toutes les figures et tous les tableaux ont été tra-vaillés pour être le plus lisibles possible. Le choixdes couleurs et des tons a notamment fait l’objetde plusieurs reprises et améliorations. »
Pour l’étudiant et le grand public
Selon le chercheur, le premier rôle desPresses de l’Université de Montréal se situe ducôté des étudiants. «Les ouvrages publiés repré-sentent une base de travail et des outils intéres-sants pour les étudiants. Le passage du professeuraux étudiants ne pourrait se faire aussi facile-ment sans les PUM.»
Mais, au-delà de la communauté étudiante,les recherches publiées peuvent atteindre unpublic plus large et être dif fusées à plusgrande échelle. « Sans les PUM, je sortirais unpetit polycopié que je distribuerais à mes étu-diants, mais ça n’irait pas plus loin. Or nos li-vres sont dif fusés dans toute la francophonie etnous pouvons faire passer notre message à toutela communauté. Ils peuvent prétendre à une dimension internationale. »
Le guide thérapeutique à paraître bientôtcomprendra par exemple un tableau des médi-caments français et canadiens, qui permettrade s’adresser à une clientèle française. « Avecles échanges entre la France et le Québec, il y ade plus en plus de médecins et d’infirmiers (ères)étrangers qui travaillent ici et qui ne connaissentpas forcément tous les médicaments locaux. »
Une science en françaisCes publications répondent à des spécificités
aussi bien linguistiques que géographiques.Pierre Beaulieu insiste sur l’importance d’avoir,au Québec, un tel organisme en langue fran-çaise. « Il y a un manque dans l’édition scienti-fique en français : la plupart des livres que nousfaisons lire à nos étudiants sont en anglais. »
Il existe aussi des spécificités québécoises enla matière, qui gagnent à être publiées par desmaisons d’édition locales. « Il y a une école enpharmacologie. Les experts ne sont pas toujoursles mêmes. Avec les PUM, nous pouvons mettrel’accent sur ce qui nous semble important. Aulieu de manuels écrits par des Américains, nouspouvons mettre en avant notre vision de notrepratique clinique, mieux adaptée à la popula-tion, et éviter de travailler uniquement à partirde traductions. C’est important de soutenir lesPUM, sinon c’est la mort de l’édition en fran-çais », affirme-t-il.
Des publications très spécialiséesDirecteur du Centre international de crimi-
nologie comparée, professeur à l’Université deMontréal et titulaire de la Chaire de recherchedu Canada en sécurité et technologie, BenoitDupont a codirigé, avec Samuel Tanner, l’ou-vrage intitulé Maintenir la paix en zones post-conflit : les nouveaux visages de la police et paruaux Presses de l’Université de Montréal enaoût 2012.
Benoit Dupont a pu mesurer l’importancedes presses universitaires lors de la publica-tion de cet ouvrage. En effet, alors que ce li-vre retrace les résultats d’un atelier de re-cherche sur le rôle de la police dans des opé-rations organisées par l’ONU dans différentspays, Benoit Dupont apprécie la possibilité dedif fuser ses recherches hors des grands cir-cuits commerciaux. « Les maisons d’édition
universitaires publient des projets des-tinés à la communauté intellectuelle,qui n’est pas forcément très dévelop-pée. Ce type d’ouvrage s’adresse à unpublic réduit : ce n’est pas un best-sel-ler. Il est réellement important qu’unemaison d’édition puisse soutenir desouvrages aussi spécialisés. »
Le livre regroupe ainsi des étudesde cas concernant des policiers issusde tous les pays. Parmi les problèmesauxquels les policiers sont régulière-ment confrontés, citons le choc cultu-rel vécu au contact d’autres policiersissus de pays où la police n’a ni lemême rôle, ni le même statut qu’ici,et qui ont des pratiques très dif fé-rentes. Certains policiers sont égale-ment confrontés à des populations quin’ont aucune confiance dans lesforces policières, ou encore à des si-tuations complexes auxquelles ilssont mal préparés. « Souvent, les poli-ciers envoyés là-bas connaissent mal lesconflits, ses origines, l’histoire. Ils sont
parfois confrontés à des groupes ethniques qui sedétestent depuis des décennies ou des siècles. Surle terrain, ils doivent réapprendre leur métier. »
Une belle factureSelon Benoit Dupont, les PUM sont d’autant
plus nécessaires dans le paysage éditorial qué-bécois qu’il s’agit d’une maison d’édition uni-versitaire en français : « Les grosses maisonsd’édition anglophones n’ont aucun intérêt à pu-blier des ouvrages en français. Le Québec est unmarché restreint et ils ne pourront vendre qu’unecentaine d’exemplaires des ouvrages. De plus, ilsn’ont pas l’expertise pour faire ce genre de chose :ils n’ont pas les canaux de distribution et de pro-motion nécessaires. »
Benoit Dupont dit apprécier par ticulière-ment le soin accordé à la mise en pages. Augage de sérieux et de rigueur apporté par lasanction universitaire de l’ouvrage s’ajoute unsouci de l’agréable : « Ce sont des livres d’unebelle facture, ce qui n’est pas toujours le casdans les éditions universitaires. Les résultatssont d’une très grande qualité, tant au niveaudu contenu éditorial que de l’aspect général. »Mais la maison fait plus que publier : elledonne l’impulsion d’une réflexion au seind’une communauté intellectuelle. Ainsi, l’ou-
vrage en question a fait l’objet d’un lancementà la librairie Olivieri, auquel ont été conviésspécialistes, lecteurs et curieux. « Nous noussommes sentis accompagnés dans ce processus »,insiste Benoit Dupont.
Sur l’aménagement de plusieurs villesde l’Asie
Titulaire de la Chaire UNESCO en paysageet environnement et de la Chaire en paysage etenvironnement de l’Université de Montréal,Philippe Poullaouec-Gonidec est l’auteur d’unedemi-douzaine d’ouvrages publiés aux PUM,auxquels s’en ajoutera un nouveau au prin-temps 2013.
Depuis 2003, Philippe Poullaouec-Gonidecdiffuse, en collaboration avec les PUM, ses ré-flexions sur l’aménagement des territoires dedemain, qu’il s’agisse du Québec ou des villesdu monde entier. Selon lui, la formule despresses universitaires comporte plusieurs avan-tages précieux, notamment le fait que les ou-vrages puissent atteindre les librairies et les bi-bliothèques francophones du monde entier.«Nos livres continuent à vivre au-delà des sallesde cours», note-t-il.
L’auteur salue ainsi la politique de prix adop-tée par les presses, qui permet aux livres d’êtreaccessibles et plus facilement diffusés. La col-lection «Paramètres», dans laquelle ont été pu-bliés certains de ses livres, « a l’avantage d’unformat réduit et peu dispendieux. Ce sont des li-vres que les étudiants peuvent acheter. » Lors deses dif férentes collaborations avec les PUM,les rares corrections imposées allaient dans lesens d’une plus grande facilité de diffusion : « Ils’agissait chaque fois d’amener l’information demanière plus fluide, d’ajouter des photos et desoigner les cartes. »
Vers la communauté internationaleÀ travers une autre collection lancée en 2005
et intitulée « Architecture de paysages », l’au-
teur s’adresse à la communauté internationale.En ef fet, ses Workshops retracent des expé-riences menées à travers l’UNESCO en Tuni-sie, au Liban, au Maroc ou en Asie, répondant àune démarche commune : « Comment faire lesvilles au XXIe siècle ?»
L’ouvrage à paraître sous peu dans le cadrede cette collection concerne trois expériencesparallèles pilotées en Chine, en Corée du Sudet au Japon et conclut trois ans de travail.« Nous avons amorcé cette activité à travers lemonde pour se sensibiliser les uns les autres ettrouver des solutions aux problèmes locaux.Toutes les villes doivent repenser ce qu’elles sont.C’est un laboratoire à l’échelle mondiale, permet-tant de prendre conscience des enjeux de culturedif férents, de favoriser le dialogue et de partici-per à la sensibilisation planétaire des architecteset des designers. »
Si les chercheurs ont eu l’idée de proposerces expériences à la publication, ce sont lesPUM qui ont décidé d’en faire une collection àpart entière. « Ils ont trouvé l’initiative nouvelle,inventive et créative. » Mais la clé de la réussitedes PUM, avance Philippe Poullaouec-Gonidec,est leur directeur. «Antoine Del Busso est un di-recteur très ouvert et créatif. Il ne dira jamaisnon aux bonnes idées. »
De même, l’ouvrage Montréal en paysages,publié en 2011, se présente comme un outil deréflexion et de travail destiné aux spécialistesde l’aménagement. « Nous pouvons donner auxélus, aux gestionnaires municipaux ou aux asso-ciations des outils et un point de vue sur cequ’est le paysage montréalais. » Selon le cher-cheur, il ne fait aucun doute que les pressesuniversitaires ont leur place. « Nous avons be-soin de publier nos connaissances. Toutes lesgrandes universités doivent avoir leurs presses :c’est un canal de dif fusion essentiel. »
CollaboratriceLe Devoir
Qu’il s’agisse de criminologie, de pharmacologie, d’aménagement urbain ou de conseils pra-tiques adressés aux étudiants, les Presses de l’Université de Montréal rejoignent l’ensemblede la communauté universitaire. Benoit Dupont, Pierre Beaulieu, Philippe Poullaouec-Goni-dec et Marie Lambert-Chan collaborent, chacun dans son domaine, aux PUM.
ARCHIVES LE DEVOIR
Pierre Beaulieu, professeur en pharmacologie,apprécie que les PUM permettent une dif fusiondes recherches dans toute la francophonie.
YVES LACOMBE
Journaliste au journal Forum de l’Université deMontréal, Marie Lambert-Chan est l’auteur duPetit guide de survie des étudiants.
ARCHIVES LE DEVOIR
Benoit Dupont a pu mesurer l’importance despresses universitaires avec la publication d’unouvrage qu’il a codirigé.
QUENTIN PHOTOGRAPHE
Depuis 2003, Philippe Poullaouec-Gonidecdif fuse, en collaboration avec les PUM, sesréflexions sur l’aménagement des territoires.
Mais, au-delàde lacommunautéétudiante, les recherchespubliéespeuventatteindre un public pluslarge et êtrediffusées àplus grandeéchelle

É D I T I O NL E D E V O I R , L E S S A M E D I 2 7 E T D I M A N C H E 2 8 O C T O B R E 2 0 1 2 I 5
ANALYSE
De l’avenir des revues dites savantes
PROFESSION
Sur «qui fait quoi» dans le monde universitaireDix-sept professions, dix-sept titres et… treize à venir
M A R I E - H É L È N E A L A R I E
Q ue fait l’astronome ? Pour-quoi devenir lexico-
graphe ? Qui est éthicien ? Y a-t-il encore des latinistes ? Voilàle genre de questions aux-quelles tentent de répondreles 17 ouvrages de la collec-tion «Profession».
Benoît Melançon, le direc-teur scientifique des Pressesde l’Université de Montréal,professeur titulaire etdirecteur du Départe-ment des littératuresde langue française,est assez fier de sacollection. Il nous ex-plique comment toutça a commencé : «Unjour, au conseil scien-tifique des Presses del’Université de Mont-réal (PUM), on discu-tait sur la nécessitépour nous d’avoir unepetite collection. Onne pouvait pas refaire“Que sais-je ? ”. On nepeut pas refaire “ Ro-bert à la découverte ”.Et je me suis dit qu’ilexistait encore unequestion à laquelle ces collec-tions ne répondaient pas : c’estcelle du travail concret des pro-fesseurs d’université. On a ainsicréé une petite collection de vul-garisation qui sert à mettre enrelief très précisément et trèsconcrètement ce que ça fait, unprof d’université, dans la vie,parce que beaucoup de gens nele savent pas. »
Tout publicCes livres sont destinés au
grand public : il est le premierpublic visé. Il y a aussi un au-
tre public, qui est celui desétudiants, de ceux qui arriventà la fin du cégep ou au débutde l’université : « Ils savent àpeu près ce qu’ils veulent faire,mais ils peuvent parfois hésiterentre deux disciplines et se de-mander : “Est-ce que j’aimeraismieux la sociologie ou l’his-toire ? ”» Les titres de la collec-tion sur ces deux sujets, quisont connexes, expliquentainsi clairement les dif fé-
rences entre les disci-plines et montrent cequ’elles représententcomme travail,comme débouchés etcomme investisse-ment intellectuel.
« Ce qu’on essaie defaire, c’est de toucherces deux publics, cequi signifie qu’on pro-pose des livres courts,qui s’appuient sur unepar t au tob iogra -phique, sans toutefoisemployer un langagetechnique », expliqueBenoît Melançon.
Afin qu’une homo-généité se dégage dela collection, Benoît
Melançon utilise ainsi un ca-nevas de questions qu’il pro-pose à ses auteurs : « Je dis auxauteurs : “ Voilà les questionsauxquelles j’aimerais que vousrépondiez. Vous avez chacunune approche par ticulière devotre travail, mais réfléchissezà partir de ça. ” Je demande àmes auteurs de dire rapide-ment pourquoi ils sont là etpourquoi ils sont devenus cequ’ils sont devenus. »
Selon chaque auteurC’est ainsi que, dans la col-
lection, vue comme un ensem-ble, chacun des ouvrages re-flète la personnalité de son au-teur, principalement dans lasection autobiographique :
« Prenez Profession philo-sophe, de Michel Seymour :c’est un texte très personnel quiexplique pourquoi et commentil est philosophe aujourd’hui,
alors que, dans d’autres textes,ça passe par une seule phraseou une parenthèse où l’auteursubitement se révèle. » Rienn’est toutefois jamais imposé.Ce sont des lignes directricesqui sont données, non desconsignes formelles.
Le grand défi de la collec-tion consiste à choisir les pro-fessions qui y apparaîtront. Etles livres doivent porter la si-gnature d’universitaires ayantune certaine expérience : « Jecherche donc des professeursqui sont engagés depuis relati-vement longtemps dans leurcarrière, parce que je veuxqu’ils aient le recul suf fisantpour expliquer la variété descheminements possibles. Parexemple, dans la profession decriminologue, Jean Proulxn’est pas le même crimino-logue au début et à la fin de sacarrière. »
Selon les disciplinesOn tentera aussi d’équili-
brer les titres en les par ta-geant entre les professions.« Je constate, en regardant lecatalogue actuel, qu’il y abeaucoup de titres qui sont dumonde des lettres, des scienceshumaines et des humanités,quelques-uns des sciences so-ciales. Et on devra développerle côté des sciences plus dures »,confie Benoît Melançon, qui,ne l’oublions pas, est profes-seur au Département des litté-ratures : comme si ceci expli-quait cela !
Mais l ’autre explicationvient aussi du fait que, danscer taines disciplines, il estplus facile de trouver des au-teurs pour qui écrire sera na-turel : « Quand j’ai demandé àFrançois Wesemael de faireProfession astronome, il m’arépondu que, dans son secteur,personne n’écrivait de livre etsur tout pas un livre pour ra-conter sa vie ! »
Tout ça nous ramène à labase, à la raison première de
la collection : «Ça oblige les au-teurs à se mettre à l’écart d’eux-mêmes et à se poser la question :“Qu’est-ce que je fais? Pourquoije fais ça? ” C’est véritablementune question que tous les uni-versitaires se posent. C’est unexercice qu’on fait spontané-ment, mais aucune collectionne posait cette question et n’y ré-pondait de façon systématiqueet publique », rappelle M. Me-lançon.
Téléchargement gratuitDepuis quelque temps, il
est possible à quiconque detélécharger gratuitement untitre de la collection. C’estune décision commercialeque ne regrette pas BenoîtMelançon : « Notre idée, c’estde faire en sorte que ces petitslivres soient visibles et qu’ilssoient lus. Notre idée, c’est dedire : “ Venez en lire un et vousallez aimer ça ! ”» Mais il nefaudra pas oublier que cer-tains titres profitent déjàd’une distribution plus large,puisqu’ils sont devenus desmanuels scolaires. Professioncriminologue est une lectureobligatoire en première an-née à l’Université de Montréalen criminologie et est aussiinscrit au programme àl’École de police de Nicolet.
La collection devrait conti-nuer à grandir au rythme detrois titres par an pour attein-dre le chif fre de 30 : « Je saisdéjà ce que sera le trentième,et c’est moi qui vais le faire.Ça va porter le titre de Profes-sion universitaire ! Chaquefois, je fais des découvertes surchacune des professions du ca-talogue. Même si ce sont descollègues que je côtoie réguliè-rement, je peux dire que,quand je les lis, j ’apprendsconstamment des choses éton-nantes » , conclut en riantBenoît Melançon.
CollaboratriceLe Devoir
Parmi les 14 collections des Presses de l’Université de Mont-réal se cache «Profession» : 17 titres à ce jour, pour permet-tre à tous de découvrir et de comprendre les diverses profes-sions universitaires. Et ces ouvrages peuvent être téléchargésgratuitement.
SOURCE ACFAS
Le directeur scientifique des PUM, Benoît Melançon, est très fierde la nouvelle collection «Profession», qui vulgarise le travail desprofesseurs d’université en s’adressant à un large public.
M I C H E L P I E R S S E N S
J ournal des Sçavants et Phi-losophical Transactions ont
produit beaucoup de petits etil s’en crée chaque jour des di-zaines, peut-être des cen-taines, toutes « savantes »,dans la mesure où elles pu-blient des ar ticles signés de« savants » patentés — pourl’essentiel, de ceux qu’on ap-pelle depuis la seconde moitiédu XXe siècle des « scienti-fiques » et, plus généralement,des scholars (l’usage franco-phone est plus diversifié maispas toujours très clair).
Mais il a fallu attendre l’in-vestissement massif des Étatsdans la « société du savoir »(l’expression est récente, maispas l’idée), por té par l’élan nationaliste et pas toujours désintéressé, pour que l’ar-gent commence à couler deplus en plus abondammentdans le réseau complexe de lacommunication scientifique :vers les laboratoires, d’uncôté, vers les regroupementsde chercheurs, de l ’autre,puis, de plus en plus, vers lessupports de dif fusion : les re-vues et leurs éditeurs.
Les montagnes de papierqui font exploser les réservesdes bibliothèques en sont lerésultat matériel visible — mais celui-ci ne le resterapas longtemps : chacun saiten ef fet que le règne du pa-pier touche à sa f in et quel’avenir n’est plus à la maté-rialisation des connaissancesnouvelles sous la forme tradi-tionnelle de la revue savante,mais au contraire à leur dé-matérialisation, y compris ré-
trospective, de telle sorte quecoexistent aujourd’hui dansle « nuage » le premier nu-méro du Journal des Sçavantset le dernier numéro de Na-ture. Les occasions of fer tespar le potentiel de la virtuali-sation n’ont pas échappé auxgrands groupes d’édition sa-vante, cer tains étant noble-ment anciens comme Else-vier, les autres étant des nou-veaux venus résolument ins-tallés dans la culture techno-logique et financière du Web2.0 et qui attendent en sali-vant le Web 3.0. Le résultat leplus tangible en est l’explo-sion et l’infinie diversificationdes revues savantes, le toutsignifiant des coûts (et desrevenus)exponentiels.
Nouveaux réseauxAujourd’hui, d’après de ré-
centes études sur le sujet, lesbibliothèques universitairesont globalement moins d’ar-gent que dans les années pas-sées, mais elles en dépensentune fraction toujours crois-sante pour payer les abonne-ments aux revues savantesélectroniques — au détrimentdu personnel, plus techniquemais moins nombreux, et àl’avantage des architectes, quidoivent inventer des lieux nou-veaux bientôt vides de livreso u d e r e v u e s i m p r i m é e s à consulter.
Déjà les collections an-ciennes ont rejoint d’inaccessi-bles bunkers, quand elles nesont pas détruites ou mises àla poubelle (pour le bonheurde collectionneurs un peu per-vers mais avisés). L’augmenta-tion des coûts engendrée par
ce changement de paradigmedevait entraîner une révolte, etc’est bien ce qui se passe au-jourd’hui avec la montée enpuissance des mouvementspour la gratuité de l’accès auxrésultats scientifiques. L’idéede fond est que le public a déjàpayé collectivement pour laproduction de ces connais-sances et que celles-ci de-vraient donc lui être redistri-buées sans frais.
Belle idée, en effet, dont leseul tort est de négliger que lagratuité a toujours un coût etque celui-ci ne se résume pasà l’investissement initial dansla recherche, dans les labora-toires ou dans les systèmesuniversitaires en général.L’énorme machinerie technofi-nancière qui remplace le pa-pier par du virtuel doit à sontour être financée. Mais parqui et comment?
Nous en sommes là au-jourd’hui, et des décisions dif-ficiles, mais majeures, devrontêtre prises. Les revues sa-vantes n’en sont que l’un desparamètres, mais il est crucial.On sait bien en effet que le fi-nancement de la recherches’oriente pour l’essentiel enfonction de la visibilité des tra-vaux, des chercheurs et deleurs publications : pas de pro-motion, pas de subventions,pas de moyens, donc pas decarrière sans en passer par là.
DécisionsPour une petite société
comme le Québec, d’une ri-chesse relative, dont les uni-versités ne figurent pas (mal-gré cer tains succès) au toutpremier rang des plus produc-tives selon les paramètres desorganismes d’évaluation inter-nationaux, les choix sont deplus en plus difficiles.
En matière de revues sa-vantes, ces outils incontourna-bles de la notoriété dans la
compétition internationale, denombreuses questions se po-sent : faut-il en créer pour es-pérer échapper aux mono-poles en place ? Faut-il investirplus massivement dans le sou-tien aux chercheurs et aux la-boratoires les plus suscepti-bles de décrocher de bons fac-teurs d’impact ? Faut-il conti-nuer à payer — coûte quecoûte, littéralement — lesabonnements aux prix désor-mais exorbitants mais qui ga-rantissent l’accès immédiataux recherches de pointe ? Àcôté de ces questions qui en-gagent des choix de société
très lourds, il faut aussi faireune place à des considérationsun peu moins stratégiques etun peu plus abstraites sur lanature même des revues sa-vantes, dont les fondementssont aujourd’hui aussi en mu-tation profonde.
Les brèves considérationsqui suivent vaudront cepen-dant moins pour les revuesscientifiques « dures », déjàtransformées, que pour celles— pas moins « savantes »,pourtant — que produisent les« sciences humaines » au senslarge ou les humanities (leterme implique un peu moinsde scientisme et un peu plusd’«humanité» que l’expressionfrançaise). À côté des grandesrevues liées à des organisa-tions disciplinaires for tes etparfois très anciennes (asso-ciations, académies, grands la-boratoires, etc.), la seonde
moitié du XXe siècle a vu semultiplier les revues que jequalifierai d’« af finitaires » —nées de la convergence d’inté-rêts intellectuels de groupeshétérogènes (disciplines di-verses, localisations diverses,réseaux éclatés, etc.). La créa-tion d’une revue était alors l’ex-pression d’une pensée com-mune for te et la revue elle-même était un outil de renfor-cement et de diffusion de cettepensée.
Ce modèle, il faut en êtreconscient, a peu de chancesde survivre aux révolutions encours. La faute en est entière-
ment à la numérisa-tion et à la dématéria-lisation, qui est entrain de devenir la rè-gle de fait. En ef fet,grâce à la complexitécroissante des sys-tèmes d’indexation,le lecteur va désor-mais directement àl’ar ticle qui l ’ inté-resse, voire à la frac-
tion d’article qui présente telou tel mot recherché, et il né-glige sans scrupules tout lereste. Sauf un travail minu-tieux de la rédaction de la re-vue pour bien organiser les re-lations entre les composantesde chaque numéro, il s’entiendra là. Ce qui faisait l’en-jeu essentiel de la revue etune large part de sa justifica-tion disparaît donc.
Mais parler de « numéro »est déjà en par tie un ar-chaïsme. Ce n’est que parconformisme ou fidélité assu-mée aux traditions que les re-vues se pensent encore selonle modèle de la périodicité ré-gulière (mensuelle ou trimes-trielle le plus souvent, annuelleparfois). Rythme logique dansun système qui repose sur desprocédures d’édition, de fabri-cation, d’abonnement, de dis-tribution, etc., qui s’organisent
de manière régulière dans letemps, avec des pauses plus oumoins longues entre les paru-tions — dispositif commodepour les éditeurs comme pourles lecteurs à l’ancienne.
MalléabilitéAujourd’hui, et encore plus
demain, c’est une tout autretemporalité qui s’impose : lapublication est désormais po-tentiellement permanente,fluide, révisable, sans mêmeparler de son caractère multi-média infiniment malléable —bien loin des rigidités du pa-pier et de la presse à imprimer.Qu’est-ce que peut alors deve-nir une revue savante qui subitune pareille transmutation ?Que deviennent ses agents tra-ditionnels ? Le rôle des contri-buteurs, des comités de rédac-tion, des éditeurs, des dif fu-seurs, des bibliothèques etmême des lecteurs ne doit-ilpas être alors profondémentrepensé et reconstruit ?
C’est dans ce sens, mais dansce sens seulement, que les re-vues savantes sont en train devivre leur fin. Pourtant, pas plusqu’au XVIe siècle l’imprimerien’a fait disparaître le savoir enfaisant disparaître l’ancien par-chemin calligraphié, il nes’agira d’une disparition défini-tive des revues ou des « sa-vants» ; parions bien plutôt surla pensée autrement stimulanteque ce que nous vivons est unerenaissance, non une déca-dence. L’histoire l’a souventdéjà prouvé: mieux vaut travail-ler en regardant l’avenir qu’yrésister vainement.
Michel Pierssens est professeurau Dépar tement des littéra-tures de langue française del’Université de Montréal. Sonplus récent projet de rechercheporte sur les savoirs des femmesen France dans la littérature etla société fin-de-siècle.
Il peut paraître paradoxal d’évoquer la fin des revues savantesalors que, depuis la création en 1665 du Journal des Sça-vants et des Philosophical Transactions, on estime qu’il s’estpublié à ce jour plus de 50 millions d’articles et que leurnombre croît à un rythme ef fréné.
L’idée de fond est que le public adéjà payé collectivement pour laproduction de ces connaissances etque celles-ci devraient donc luiêtre redistribuées sans frais
«Ça oblige lesauteurs à semettre àl’écart d’eux-mêmes et à se poser la question:“Qu’est-ce queje fais?Pourquoi jefais ça?”»

Albert AdamLa science du vin pour amateurs éclairés
Marie Lambert-ChanLe métier d’étudiant décortiqué
Jean Després (dir.)« Un livre tout à fait exceptionnel ! » — Pierre Gingras
Martine BélandLa philosophie comme thérapie Joanne Guay, René Martin
et Benoît Plaud (dir.)Abrégé de la 5e édition
Samuel Tanner et Benoit Dupont (dir.)Les nouveaux visages de la police
Charles-Philippe David (dir.)Auteurs, concepts et approches
Raynald PineaultSimplifier pour mieux comprendre
François Aubry et Louise Potvin (dir.)La production locale de la santé
Valéry Ridde et Christian Dagenais (dir.)Nouvelle édition revue et augmentée
Monique Tardif, Martine Jacob, Robert Quenneville et Jean Proulx (dir.)Approches cliniques
Gérard Beaudet, Jean-Philippe Meloche et Franck Scherrer (dir.)Les problèmes des grandes villes
Francine Ferland et Élisabeth Dutil Histoire d’une profession
Valéry RiddeAu-delà des idéologies et des idées reçues
Germain Lacasse, Johanne Massé et Bethsabée Poirier L’émergence de la modernité au Québec
Lila Combe, Michel Gariépy, Mario Gauthier, Florence Paulhiac Scherrer, Franck ScherrerPlanification urbaine et développement durable
Gaston GodinComprendre pour mieux intervenir
John MacFarlaneUne étude de l’héroïsme militaire
UN DES 17 TITRES DE LA COLLECTION « PROFESSION »
www.pum.umontreal.ca Offre valide jusqu’au 30 novembre 2012
Profession
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
PRIX ET DISTINCTIONS 2012
Karine Cellard, Prix Gabrielle-Roy
Yannick Roy, finaliste Prix du Gouverneur général
Normand Chaurette, Prix Spirale-Éva-Le-Grand, finaliste Prix du Gouverneur général,
Julien Prud’homme, Prix Michel-Brunet Simon Jolivet, Prix de l’Assemblée nationale
Martin Jalbert, Prix Jean-Éthier-Blais
REVUES
CHANTAL BOUCHARD
La légitimité linguistique du français parlé au Québec
Les Presses de l’Université de Montréal
Mechante langue´
Jean-François Vallée, Jean Klucinskas et Gilles Dupuis (dir.)Notre ère bigarrée
Isabelle Tremblay Stratégie narratives des romancières des Lumières
Dr Jean Wilkins Plaidoyer pour une approche clinique humaine
Rosalind Silvester et Guillaume ThouroudeLa francophonie chinoise et son histoire
William Brock Pour la recherche médicale
Chantal BouchardLa légitimité linguistique du français parlé au Québec
Les Presses de l’Université de MontréalSuivez-nous @PressesUdeM



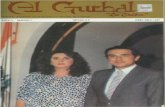












![[Page 1] [Page 2] [Page 3] Claves - EL OLIVO · [Page 1] [Page 2] [Page 3] ... esta modesta tarea. Nadie estará más consciente de sus faltas que yo mismo, a pesar de que confío](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5f01bd437e708231d400cdc5/page-1-page-2-page-3-claves-el-page-1-page-2-page-3-esta-modesta.jpg)


